PHYSIOGNOMONIE
Chercher à savoir au plus vite, d’après son aspect, si la personne qui croise notre route peut nous nuire ou nous être bénéfique, correspond sans doute à un de nos instincts vitaux. Aujourd’hui cependant, si l’on met à part les expressions fugitives, seuls certains symptômes visibles d’états pathologiques et certains comportements (au nombre desquels figure la façon de se vêtir, de se coiffer, etc.) nous paraissent objectivement susceptibles de nous révéler sur un simple regard quelque chose d’autrui. On avait plus d’ambition autrefois. Une «science», la physiognomonie, se proposait de lire à coup sûr, dans les traits permanents du visage et du corps, les dispositions naturelles, les mœurs, le caractère. Elle se présentait comme «l’art de connaître les hommes» et notamment de percer à jour les méchants en dépit de leur dissimulation. Elle intéressait donc, outre tout un chacun, les ancêtres du psychologue, le philosophe et le médecin.
Les premiers écrits de physiognomonie remontent à l’Antiquité grecque et romaine. Recueillie et quelque peu transformée par les Arabes, de nouveau connue en Occident à partir du XIIe siècle, elle s’est beaucoup développée au XVIe et a atteint son apogée dans le dernier tiers du XVIIIe siècle avec Johann Kaspar Lavater, en dépit de nombreuses réticences et oppositions. Au XIXe siècle, l’héritage de la physiognomonie est passé dans les travaux d’un certain nombre de psychologues et de médecins comme Cesare Lombroso, fondateur de l’anthropologie criminelle, mais l’évolution des connaissances dans les domaines de l’anatomie, de la physiologie, du psychisme, etc. a peu à peu ruiné ses appuis scientifiques et ses fondements théologiques ne sont plus opérants. Cela ne l’empêche pourtant pas de survivre – comme toutes les connaissances non objectives qui ne rencontrent jamais le réel – et souvent sous sa forme la plus inquiétante: le racisme n’a pas manqué d’y avoir recours. On la retrouve dans les magazines féminins, par exemple, où, dans la lignée du sâr Péladan, auteur d’un Art de choisir sa femme d’après la physionomie , on fournit des conseils pour reconnaître, d’après la bouche ou les sourcils, le ou la partenaire à rechercher ou éviter. Plus sérieusement, elle reste utilisée, sous le nom de «morphopsychologie», avec d’autres références et un vocabulaire modernisé, dans les pratiques du recrutement et elle est enseignée dans des écoles de commerce où l’on veut apprendre à mieux «cerner» le client potentiel. Plus sérieusement encore, on s’est proposé de «prolonger ou de dépasser Lavater» pour, à son exemple, chercher à extraire des informations des «seules surfaces», «sauver les phénomènes» et «fonder une certaine psychophysique» (F. Dagognet, 1982).
De telles survivances ou résurgences fourniraient déjà une raison de garder en mémoire l’histoire de la physiognomonie. Mais, de toute façon, elle fait partie intégrante de l’histoire des idées et celles qui la sous-tendaient dans l’Antiquité, à la Renaissance et au XVIIIe siècle ayant leur dignité, on aurait tort de ne lui réserver que du mépris. Enfin et surtout, la physiognomonie, ou du moins l’esprit physiognomonique, ont joué un rôle important dans la création littéraire et artistique.
D’Aristote à Lavater
Le texte fondateur de la physiognomonie, les Physiognomonica , fut longtemps attribué à Aristote lui-même et appartient sans doute à son école. Plus tard, trois autres auteurs y puisèrent tout en le complétant: le sophiste grec Polémon (IIe s. apr. J.-C.), un anonyme latin parfois identifié à Apulée (IIIe ou IVe s.) et le médecin et sophiste juif Adamantius (IVe ou Ve s.). À la base, un postulat auquel divers courants philosophiques apportent leur explication sous forme de mythes: il y a une étroite interdépendance entre l’âme et le corps qu’elle a façonné. De même que pour soigner l’un il faut passer par l’autre, pour connaître l’âme il faut donc regarder le corps: l’aspect de ses différentes parties permet de déceler les inclinations et les penchants naturels. Les traités se divisent en deux sections. Dans la première, on dresse la liste des segments du corps, en commençant par la tête, avec en regard les indications d’ordre moral qu’ils fournissent selon leur forme, leurs dimensions, leur couleur. L’éclat des yeux, le timbre de la voix, la démarche et les mouvements comptent parmi les traits permanents, au même titre que la morphologie: couleur des cheveux, forme du front, du nez, du dos, etc. La seconde section donne la liste des «caractères» (au sens de Théophraste) avec en regard les traits physiques correspondants. Il y a donc double entrée.
Pour établir leurs listes de signes physiques et de significations morales, les physiognomonistes antiques ont peut-être fait appel à des observations personnelles, mais ils ont surtout eu recours aux lieux communs sur les sexes et les âges et à tous les textes donnant des portraits à la fois physiques et moraux: ceux de la médecine humorale, selon laquelle les tempéraments résultant de la prédominence d’une humeur se manifestent à la fois par l’aspect et le caractère; de l’historiographie, qui dépeint les grands hommes; de la géographie, qui décrit le faciès et les mœurs des habitants des divers «climats»; et surtout de l’histoire naturelle et de la fable ésopique, avec ses animaux bien connus: le rusé renard, le bœuf lent et obtus, l’aigle impérieux, le lion courageux et superbe, etc. Par une démarche essentiellement symbolique, les physiognomonistes ont ensuite mis en rapport chaque trait physique avec un trait moral. Par exemple: Artaxerxès avait les bras très longs, c’est par là que se révélaient son audace et sa munificence. Ou encore: ce sont les extrémités fortes du lion qui indiquent sa force de caractère. Ensuite, il suffisait de retrouver l’un ou l’autre de ces traits physiques chez l’homme examiné pour en inférer qu’il possédait aussi le trait moral correspondant.
La physiognomonie semble avoir joui d’un certain prestige dans le monde antique, où circulaient des anecdotes sur le talent de divers praticiens, par exemple Zopirus, qui serait parvenu à déceler le mauvais naturel de Socrate. «J’étais ainsi, aurait répondu Socrate, mais j’ai su dominer ma nature.» Se connaître soi-même pour pouvoir se corriger était un des buts de la physiognomonie classique, à côté de la connaissance d’autrui, et les auteurs n’ont pas manqué de le souligner.
Les traités antiques étaient depuis longtemps perdus de vue en Occident lorsque, à partir du Xe siècle, les Arabes les redécouvrirent et les traduisirent, les abrégèrent ou les complétèrent. Mais, en même temps, un autre courant ressuscitait de très anciennes croyances astrologiques selon lesquelles les planètes impriment des signes (lignes, taches, grains) sur le corps. On les lira donc sur le visage (métoposcopie) et sur la main (chiromancie) pour connaître le caractère, mais aussi et surtout pour prédire l’avenir. D’autre part, le physiognomoniste est présenté par les traités arabes comme un mage, un voyant, et son rôle dans la vie pratique est réputé indispensable. Conseiller des rois et des chefs de famille, il pourra faire jouer son art pour sélectionner ministres, serviteurs, amis, épouses, esclaves, chevaux même, et pour démasquer les criminels.
L’Occident méditerranéen connut dès le XIIe siècle l’anonyme latin et les écrits naturalistes arabes. Le pseudo-Aristote lui parvint d’abord à travers une version abrégée par les musulmans, puis le traité grec lui-même fut traduit en latin en Sicile vers 1260. Mais à partir de la fin du XIIIe siècle, de très nombreux manuscrits de physiognomonie astrologique arabe parvinrent en Europe. Cette double tradition explique l’alliance durable, dans les écrits occidentaux du Moyen Âge et de la Renaissance, de la physiognomonie naturaliste et de la divination (chiromancie surtout). Bien d’autres traits d’influence arabe persistèrent d’ailleurs jusqu’à la fin du XVIe siècle, en dépit des efforts des humanistes pour favoriser le retour aux sources antiques: impression du texte grec du pseudo-Aristote chez Alde Manuce en 1497, traduction latine d’Adamantius en 1504. Par ailleurs, vers 1450, dans le Speculum Phisionomiae , le médecin Michel Savonarole (oncle du réformateur) avait entrepris pour la première fois de relier systématiquement la physiognomonie à la doctrine médicale et établi une table de correspondances entre les signes physiques et les tempéraments.
À partir des premières années du XVIe siècle, les publications se multiplient, qu’il s’agisse de l’impression de manuscrits médiévaux ou de productions nouvelles. Le XVIe siècle apparaît comme la première grande époque de succès de la physiognomonie et cela en dépit de la défiance et de l’ironie inspirées à certains, comme Léonard de Vinci ou Rabelais, par ses accointances avec l’astrologie et la divination. Un tel essor n’est pas pour étonner. Plus qu’aucune autre époque, la Renaissance a conçu l’univers comme un système de signes par lesquels le visible renvoie à l’invisible, où il convient de chercher des concordances, des analogies, des «sympathies» entre tous les constituants de l’univers comme entre l’extérieur et l’intérieur de toute chose. Le succès était sans doute dû aussi en partie aux illustrations gravées des deux «best-sellers», qui seront encore réédités au XVIIe siècle: la Chiromantie ac Physionomie anastasis de Bartolomeo della Rocca dit Cocles (Bologne, 1504) et les Introductiones in Chyromantiam, Physiognomiam , etc. de Jean de Hayn ou Indagine (Strasbourg, 1522). Des vignettes y font défiler, isolées ou par deux, des séries de têtes marquées des traits révélateurs.
Le XVIe siècle s’achève par une récapitulation générale de toute la tradition naturaliste et médicale: l’ouvrage fameux de Giovanni Battista della Porta, De Humana Physiognomia , paru à Naples en 1586 et dont les éditions et les traductions allaient se succéder de la fin du XVIe à la fin du XVIIe siècle. La volonté d’énumérer et de rationaliser toutes les données antérieures y est manifeste. Le fonds est fourni par les auteurs antiques, les références médiévales n’étant que secondaires. Mais della Porta n’hésite pas pour autant à vérifier et à critiquer leurs dires à l’aide de renseignements puisés dans les textes les plus divers, le plus souvent littéraires, antiques ou modernes. L’habituelle section de chiromancie est évacuée, comme toute allusion à la «fortune», bonne ou mauvaise, liée à tel ou tel signe physique (l’Italie vit alors sous le régime de la Contre-Réforme qui combat vigoureusement l’astrologie divinatrice). En revanche, della Porta introduit une nouvelle base d’observation: la façon de se vêtir qui, pour lui, fait également partie des révélateurs de l’âme. Mais le trait le plus caractéristique de son ouvrage est constitué par le retour en force des analogies animales chères aux auteurs antiques. Le recours y est constant dans le texte et la plus grande partie des illustrations leur est consacrée. On y trouve, d’une part, des figures historiques, dont della Porta a fait dessiner le visage d’après les marbres et les médailles des collections de sa famille, confrontées à des têtes d’animaux prises, dit-il, sur le vif. On retrouve chez Platon, par exemple, le nez et le front du chien de chasse, ce qui dénote le bon sens. Leur nez également rapproche Socrate du cerf, Galba de l’aigle, tel autre empereur d’un poisson, Politien du rhinocéros... Apparaissent, d’autre part, des figures types alliant les traits de l’homme à ceux de l’animal. C’est aujourd’hui encore l’aspect le plus connu de della Porta. Les faces hybrides de l’homme-lion, de l’homme-bœuf, de l’homme-bélier, etc., dont on ne sait si elles sont nées d’une attirance particulière pour le monstrueux ou d’un humour caché, correspondaient parfaitement au goût du maniérisme pour toutes les surprises nées d’un brouillage de frontières. Mais elles lui ont survécu longtemps.
Elles ont, notamment, fasciné Charles Le Brun: il en a redessiné certaines, avec une virtuosité et une force qui surpassent de beaucoup leurs modèles, et en a inventé de nouvelles. Le Premier Peintre de Louis XIV s’est intéressé, en effet, à la physiognomonie traditionnelle, sur laquelle il donna une conférence devant l’Académie royale de peinture et sculpture en 1671. Le texte n’est plus connu qu’à travers des documents incomplets et obscurs. On croit cependant comprendre que Le Brun cherchait à la fois à repérer les traits distinctifs opposant la face humaine au faciès animal (il pensera les trouver dans l’inclinaison des yeux, la direction du regard et le froncement du sourcil) et le moyen de mesurer le degré d’animalité (ou au contraire d’humanité, c’est-à-dire d’«élévation d’esprit») des visages humains. Ce moyen lui semblait devoir être fourni par la géométrie (le Créateur ne fut-il pas géomètre?), dans un système complexe de triangulation préfigurant Petrus Camper et la théorie de l’angle facial. Selon lui, la même triangulation permettait de déceler, chez les animaux d’abord et ensuite chez les hommes, cruauté, voracité, force, audace, intelligence, ruse, et leurs contraires.
Cette part de l’activité de Le Brun était marginale pour l’époque et devait tomber à peu près dans l’oubli jusqu’en 1806, date à laquelle ses dessins furent gravés et accompagnés d’un commentaire dans l’esprit «lavatérien» du moment. En revanche, ses travaux sur l’expression connurent un succès immédiat. Au XVIIe siècle en effet, une nouvelle branche de l’«art de connaître les hommes» se constitue à côté de la physiognomomie traditionnelle: l’étude des «passions de l’âme» et de la manière dont elles modifient le visage (pathognomonie). Le traité de Descartes parut en 1649, mais c’est l’ouvrage en cinq volumes de Marin Cureau de La Chambre, médecin et conseiller du roi: Les Charactères des passions (1640-1662), qui eut le plus d’influence. La description des «signes extérieurs» des passions y était particulièrement détaillée, mais l’ouvrage n’était pas illustré. Le Brun entreprit de mettre les idées de Descartes et surtout celles de Cureau à la portée des artistes. En 1668, il prononça devant l’Académie deux conférences illustrées de dessins sommaires qu’il mit au net dix ans plus tard en reprenant la question et qui furent gravés et publiés à plusieurs reprises. Il s’agissait d’une quarantaine de têtes, schématiques ou complètes, montrant les symptômes des passions simples et composées. La mimique était donc privilégiée par rapport au geste dans l’expression des émotions et la plus grande importance était accordée au jeu des sourcils: pour permettre aux artistes d’en saisir jusqu’aux plus infimes variations, Le Brun avait même juxtaposé en d’étonnantes séries des paires d’yeux sans visages.
À l’époque des Lumières, la physiognomonie traditionnelle devient suspecte. On ne croit plus à l’existence de règles sûres pour connaître les hommes du premier coup d’œil: les traits de physionomie sont mêlés et confus, la contradiction est même possible entre l’être intime et l’apparence. En revanche, on estime que la pathognomonie, qui étudie les signes des passions, est une science authentique et légitime. On reprend les expressions de Le Brun, on s’intéresse au jeu des acteurs.
La soudaine résurgence de la physiognomonie dans le dernier tiers du XVIIIe siècle étonnerait donc si, par bien des aspects, elle ne participait pas, précisément, à la réaction contre l’Aufklärung . Les deux principaux auteurs de traités – ils se multiplient – appartiennent aux courants irrationalistes religieux: illuminisme, théosophie, piétisme. L’abbé Antoine-Joseph Pernety (La Connaissance de l’homme moral par celle de l’homme physique , Berlin, 1776) est le fondateur d’une secte hermétiste en Avignon. Johann Kaspar Lavater, à Zurich, est un pasteur suspect à l’orthodoxie protestante, qui finira en praticien du magnétisme et en adepte de la magie, ami de Mesmer et de Cagliostro.
L’ouvrage de Lavater, Physiognomische Fragmente (Leipzig, 1775-1778) ou Essai sur la Physiognomonie (La Haye, 1781-1803), est tout entier fondé sur une conviction religieuse. Au centre: la parabole des talents. Dieu connaît le cœur et l’âme des hommes, leurs penchants, leurs capacités. En cela comme en tout, l’homme doit imiter le Créateur et donc s’efforcer de connaître les autres hommes, en utilisant le moyen suprême de toute connaissance: les sens (Lavater est profondément sensualiste, jusque dans ses écrits mystiques). En effet, rien n’est insignifiant dans l’univers, tout y est parlant, «chaque chose porte en elle une empreinte indiquant sa nature intime et son développement, un caractère spécial qui la fait connaître pour ce qu’elle est, en la distinguant de ce qui n’est pas elle». Pour Lavater comme pour les «sémiologues» de la Renaissance, tout être ou objet a un intérieur qui s’exprime par son extérieur et, pour lui comme pour Leibniz, cette expression obéit aux principes d’homogénéité et de continuité organiques («la nature forme tout d’une seule pièce et en un tout cohérent»). L’absolue diversité des corps humains (il n’y a pas deux hommes semblables) manifeste donc, selon ces principes, l’absolue diversité des âmes. Comme toute la nature et plus qu’elle encore, l’homme se présente comme un «système de signes destinés à provoquer et orienter les actions humaines» (F. Azouvi, 1978). Selon Lavater, la lecture de ces signes doit poursuivre un triple but. Elle doit confirmer aux yeux de l’homme qu’il est une créature supérieure, distincte des animaux (c’est l’époque où Goethe découvre triomphalement l’os intermaxillaire qui sauvegarde la différence originelle de l’homme par rapport au singe), et du même coup l’amener à réfléchir aux intentions de son Créateur. Elle doit permettre aux pédagogues et aux juges d’avoir une juste appréciation des hommes, selon la «justice» de la parabole des talents («L’homme est libre comme un oiseau dans sa cage. Il a sa sphère d’activité et de mobilité qu’il ne saurait dépasser [...]. Il ne peut s’élever qu’à un certain point et pas plus haut»). Contre «la philosophie de nos génies de l’école de Lucien», Lavater nie le rôle de l’éducation et des conditions de vie. Il affirme à la fois la fraternité des enfants de Dieu et l’inégalité de leurs «talents» intellectuels et moraux. La justice consistera donc à reconnaître jusque dans les êtres les plus dégradés la petite graine divine du talent pour lui donner une chance de s’épanouir et à ne pas trop exiger de ceux qui ont peu reçu. Enfin, la lecture des corps doit inspirer l’amour du bien à la vue de la beauté et l’horreur du mal devant la laideur.
Comme Shaftesbury et beaucoup de ses contemporains, Lavater postule en effet l’harmonie entre la beauté morale et la beauté physique. La vertu embellit, le vice enlaidit. En matière de beauté, le sommet a été atteint par l’homme à l’époque des Grecs (car les artistes grecs n’ont pas idéalisé la nature, mais se sont inspirés des formes qu’ils avaient sous les yeux). Ces païens, en effet, valaient mieux que les chrétiens dégénérés que Lavater voit autour de lui. Ils étaient donc plus beaux. Les Fragments s’ouvrent sur la citation d’un texte de Johann Gottfried Herder qui exalte l’image de Dieu dans l’homme et déplore qu’elle ait été profanée par le péché originel. Lavater voit partout les traces de cette profanation, mais toute amélioration morale peut faire renaître la beauté. D’autant plus que des «sympathies» mystérieuses, des effets quasi magnétiques, entre les êtres, peuvent exercer une influence favorable.
Les signes les plus importants apparaissent sur le visage. Les traits mobiles, les parties molles de la face, révèlent la vie morale. Au repos, ils permettent de lire la sensibilité, l’irritabilité, les passions habituelles; en mouvement, les affects passagers. Les parties solides de la tête et surtout le front renseignent sur la vie spirituelle et intellectuelle. C’est à elles que s’intéresse en premier lieu Lavater, et c’est pourquoi il attache une grande importance à la silhouette. On peut devenir un bon physiognomoniste par les œuvres: observer sans relâche, dessiner, mesurer, comparer, collectionner les crânes des hommes célèbres. Mais, en ce domaine aussi, la grâce (au sens théologique) bouleverse tout: rien ne vaut la possession d’une sorte de sixième sens, le tressaillement instinctif à la vue d’une physionomie. Le physiognomoniste idéal est en sympathie immédiate avec la belle âme à travers le beau corps, et cela parce qu’il est lui-même moralement et physiquement beau. On comprend dès lors que Lavater se soit présenté comme un simple «fragment» de ce parfait connaisseur des hommes et ait déclaré que son traité, lui-même fragmentaire, n’avait pour but que d’exposer les préliminaires et de préparer les matériaux d’une science future.
À cela Kant répondait: «On ne peut nier qu’il y ait une caractérologie physiognomonique, mais elle ne peut jamais devenir une science» (Anthropologie du point de vue pragmatique ). L’ouvrage de Lavater suscita, et d’abord en Allemagne, de violentes critiques. Georg Christoph Lichtenberg, professeur de physique à Göttingen, mais aussi homme de lettres et satiriste, persuadé de la dysharmonie entre le corps et l’âme (il était lui-même bossu et contrefait) et de l’ambiguïté profonde d’un «moi à double face», répliqua: «Cet être inintelligible que nous sommes nous-mêmes et qui nous paraîtrait bien plus inintelligible encore si nous pouvions nous en approcher davantage, il ne faut pas vouloir le trouver sur un front.» Selon lui, seules les traces pathognomoniques peuvent être révélatrices et le meilleur moyen de connaître les hommes est de les voir à l’œuvre. Point de vue repris par Hegel, qui déniait lui aussi au physiognomoniste le droit de prétendre connaître «le fond même» sans se préoccuper des actes (Phénoménologie de l’esprit ). Lichtenberg fit en outre paraître dans son journal une étude «physiognomonique» des catogans des étudiants de Göttingen, parodiant le ton emphatique et les jugements «inspirés» et péremptoires de Lavater.
Les controverses suscitées par les Fragments ne freinèrent nullement, au contraire, le succès de l’ouvrage, qui ne fléchira que vers 1870. En 1810 avaient déjà été publiées seize versions allemandes, vingt anglaises, quinze françaises, deux américaines, une hollandaise et une italienne. L’examen physiognomonique devint une mode, qui allait être relayée un peu plus tard par celles de la phrénologie de Franz Josef Gall et des exercices de «cranioscopie». Il est essentiel de lui restituer son côté jeu de société, mi-sérieux mi-ironique. Les idées philosophiques et religieuses qui sous-tendaient l’œuvre du pasteur zurichois n’étaient pas forcément admises, ni même connues, de tous les joueurs. Les versions populaires étaient d’ailleurs très abrégées, et la grande édition du docteur Moreau de la Sarthe (1807) donnait même une interprétation matérialiste des observations de Lavater. On a cherché des explications à ce succès prolongé, qui suffirait à lui seul à infirmer le schéma simpliste selon lequel les Fragments n’auraient été qu’une arme de la noblesse libérale et de la bourgeoisie dans la lutte des classes avant et après la Révolution (M. Dumont, 1984). Les bouleversements sociaux, la croissance rapide de la population dans les villes industrielles ont été mis en avant, sans doute à juste titre (J. Wechsler, 1982). On ne savait plus du tout, désormais, à qui l’on avait affaire et l’on cherchait à repérer les bons et les méchants au milieu des foules anonymes.
Les écrivains et la physiognomonie
Beaucoup d’écrivains ont été des admirateurs et des partisans déclarés de Lavater. En Allemagne, il faut citer Goethe, qui fut un grand ami et collabora de près aux Fragments avant de se brouiller avec lui, mais aussi Jean-Paul Richter, Novalis, Schopenhauer... En France, Madame de Staël, Senancour, Chateaubriand, George Sand, Stendhal, Balzac, Baudelaire figurent parmi les lavatériens convaincus, ainsi qu’une foule d’écrivains mineurs comme Eugène Sue. Quand on sait que Balzac a mentionné Lavater (et Gall) plus de cent fois dans la Comédie humaine et que Baudelaire appelait le pasteur zurichois: «cet homme angélique», on mesure son importance pour l’histoire littéraire du XIXe siècle. Le romantisme était en accord avec Lavater sur des points essentiels: l’intérêt pour les particularités individuelles, la valeur accordée aux liens instinctifs, aux sympathies, aux affinités qui se créent entre les êtres, le sentiment d’une profonde unité de l’univers, dont «les formes infinies», selon les mots de Balzac, ne sont que «les combinaisons d’un même mouvement, vaste respiration d’un être immense», l’écoute des lois mystérieuses de la nature, dont il est impossible de rendre raison, la foi dans l’interpénétration du monde de la matière et de celui de l’esprit, la recherche des signes divins dans la création, la fascination du fatum . Lavater n’a pas été la seule source, bien entendu. Mais lorsque Bau delaire, à propos de Victor Hugo, poète de «l’universelle analogie», évoque ceux qui les premiers ont enseigné à son siècle que «tout est hiéroglyphique», il cite seulement Swedenborg et Lavater, qui «nous avait traduit le sens spirituel du contour, de la forme, de la dimension».
Le roman était le genre littéraire le plus susceptible d’établir des correspondances systématiques entre la psychologie, la conduite, la destinée de ses personnages et leur signalement extérieur. À partir des années 1790, le véritable «climat physiognomonique lavatérien» (G. Tytler, 1982) qui domine la culture européenne, va être largement responsable des changements survenus dans la composition du portrait littéraire.
La physiognomonie, qui se présentait comme le moyen de déduire le moral du physique dans la vie réelle, permettait aussi d’accorder le physique et le moral des personnages imaginaires. La circulation à double sens des traités antiques indique bien qu’ils s’adressaient déjà au poète ou à l’orateur cherchant à tracer le portrait symbolique de l’orgueilleux, de l’avare, du magnanime, etc. On aimerait savoir si leurs indications ont été utilisées, par exemple dans les sermons, mais la recherche reste à faire.
Une chose est sûre: des origines (Homère) jusqu’au XVIIIe siècle, il règne dans la fiction ce qu’on peut appeler un esprit physiognomonique au premier degré: le moral et le physique des personnages sont toujours liés, les bons sont beaux et les méchants, laids, selon les critères esthétiques en vigueur. Ce qui change au cours des siècles, c’est la façon d’évoquer l’apparence extérieure. À la fin du XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe, on assiste à la montée du «portrait composé»: le narrateur décrit en une seule fois et en détails son personnage, qu’il soit idéalisé ou grotesque. Mais cette peinture ne sert pas encore de support à une présentation du caractère. Un peu avant la parution de l’ouvrage de Lavater, les choses commençaient à changer. On le voit avec Diderot. Comme ses contemporains, il s’intéresse surtout à l’expression (presque toujours stéréotypée) des passions et partage la méfiance de l’Encyclopédie envers l’usage de la physiognomonie dans la vie réelle. Mais, dans ses œuvres de fiction, il recourt à la physiognomonie traditionnelle pour imaginer le président-satyre, le cénobite-pourceau et le ministre-autruche du Neveu de Rameau et reprend les lieux communs sur les tempéraments (le mélancolique noir et sec), les femmes (l’amoureuse-née aux grands yeux noirs brillants), l’homme de génie dont on reconnaît de loin le front, le port de tête et le regard. Aussi n’est-il pas étonnant de le voir s’intéresser tout de suite à l’ouvrage de Lavater, vouloir le traduire dès 1775 et, tout en critiquant son «vernis de théologie mystique», en faire un compte rendu élogieux en 1782.
À partir des années 1790, le portrait du personnage de roman, en Allemagne, en France, en Angleterre, prend une dimension véritablement physiognomonique. Le goût du détail qui révèle tout un pan du caractère est poussé très loin. Toutes les apparences sont suggestives, non seulement le corps, ses traits et ses mouvements, mais la voix, l’écriture, le costume, la demeure. Les physionomies animales se multiplient. Balzac croit voir ces «ressemblances [...] inscrites sur les figures humaines et si curieusement démontrées par les physiologistes» reparaître «vaguement dans les gestes, dans les habitudes du corps» (La Peau de chagrin ). Eugène Sue en use et abuse dans Les Mystères de Paris . Au portrait composé certains préfèrent le portrait par touches successives, qui répond mieux aux observations répétées recommandées par Lavater. Ce dernier est souvent désigné comme la référence du narrateur-observateur. Et l’on trouve assez fréquemment, en effet, des emprunts directs de détails physiques accompagnés de leur interprétation morale selon Lavater. Mais on voit plus souvent encore les romanciers garder leur liberté dans le choix des détails significatifs et de la lecture à en faire. C’est l’esprit général qui compte.
Cet esprit physiognomonique a fourni bien des ressources au roman du XIXe siècle. En France et en Allemagne surtout, les apparences du personnage sont la plupart du temps concordantes et révélatrices. Ses actes ne font que confirmer les résultats de l’observation. Le roman se meut dans la conscience d’une fatalité à laquelle nul n’échappe. Cela permet de procéder, par exemple, à la reconnaissance mutuelle de deux héros destinés l’un à l’autre, ou de montrer comment le milieu physique et social forme ou déforme à jamais le corps et l’âme des individus. Mais il peut aussi y avoir des désaccords dans l’apparence, des incongruités qui alertent, une contradiction entre le «fond» de la physionomie et l’expression passagère venue la nuancer. Voici alors un délicieux suspense. Par un trait de génie, Victor Hugo fait du hideux Quasimodo un ange et de «l’homme qui rit» un désespéré; Oscar Wilde réserve au portrait de Dorian Gray les stigmates de la laideur morale, que rien ne trahit sur le visage du héros lui-même. Mais ces renversements n’ont de valeur que par rapport à la norme physiognomonique reconnue. Dans un tout autre esprit, les romancières anglaises ont parfois joué sur les apparences trompeuses et les erreurs de l’observateur, génératrices de coups de théâtre. George Eliot (Le Moulin sur la Floss ), Jane Austen (Emma ) en profitent pour montrer comment les préjugés sociaux et les partis pris personnels altèrent la perception physique d’autrui. Mais ce faisant, c’est encore par rapport à la manie physiognomonique de leurs contemporains qu’elles se situent.
Flaubert, qui a ridiculisé cette manie dans Bouvard et Pécuchet et le Dictionnaire des idées reçues , regardait l’art de la narration comme une activité fortement physiognomonique. Toutes ses descriptions, il le déclare lui-même, ont une fonction définie en relation avec le personnage et l’action. La physiognomonie, en tout cas, s’est prolongée dans le roman longtemps après avoir cessé d’être une mode universelle. On en retrouve la trace chez Zola, chez les naturalistes, chez Thomas Hardy ou Henry James. Et la diminution d’intérêt pour l’homme extérieur dans la fiction du XXe siècle ne concerne que la littérature. Le cinéma a pris la relève et il a largement utilisé les ressources de la physiognomonie.
Les artistes et la physiognomonie
La physiognomonie s’est constituée à l’origine en dehors de tout rapport avec les arts plastiques. Mais à partir du moment où les auteurs décidèrent d’illustrer leurs traités, ils devinrent étroitement tributaires des artistes. Certaines des têtes de Cocles et d’Indagine sont manifestement tirées de tableaux et de gravures. Della Porta a reproduit des bustes antiques et des portraits modernes (Pic de la Mirandole, Politien), et il a regardé le traité des proportions de Dürer, auquel il a emprunté notamment l’image des têtes concave, convexe et plate. Avant Lavater, néanmoins, la documentation des physiognomonistes était essentiellement constituée de descriptions dans des textes.
Avec Lavater, tout change. Seule compte désormais la documentation figurée. Dessinateur lui-même, il s’était constitué un «cabinet physiognomonique» (aujourd’hui dispersé) qui compta jusqu’à vingt-cinq mille gravures, dessins, aquarelles et peintures de portraits, caricatures, figures imaginaires et scènes de toutes sortes, depuis la Renaissance. Il exerçait son jugement non seulement devant des sujets en chair et en os, venus le consulter, mais aussi d’après les portraits qu’on lui soumettait. La représentation offrait même à ses yeux l’avantage de supprimer les mouvements divers et les expressions fugitives qui gênent l’observation. Enfin, il pensait pouvoir communiquer sa «science», ou plutôt ses intuitions, à travers l’illustration de son ouvrage: les Fragments se présentent avant tout comme une galerie de portraits, gravés par Daniel Chodowiecki, de l’Académie de Berlin. Son ami Johann Heinrich Füssli intervint dans l’édition anglaise de 1792 et François-André Vincent dans l’édition Moreau. Girodet-Trioson, David d’Angers paient tribut à Lavater, dans leurs écrits du moins. Mais l’alliance du physiognomoniste et de l’artiste était contre nature. Lavater, qui exalte l’art du portrait, se plaint amèrement de la plupart des portraitistes et voudrait réformer la profession. En fait, l’idéal est pour lui la silhouette tirée à l’aide d’une «machine sûre et commode» qui préfigure le physionotrace, la chambre claire, le mégascope et finalement, l’appareil photo de l’anthropométrie, c’est-à-dire, à l’opposé de l’art, la reproduction mécanique du réel.
Les artistes, de leur côté, ne pouvaient ignorer l’existence de la physiognomonie. Rendre visible l’homme intérieur était devenu à la Renaissance une préoccupation majeure des praticiens et des théoriciens. Pour Alberti, ce but devait être atteint essentiellement par la représentation des mouvements et des gestes qui trahissent les émotions. Mais Léonard de Vinci, tout en exprimant le plus grand mépris à l’égard de la métoposcopie et de la chiromancie, admettait que «les traits du visage manifestent en partie la nature des hommes, leurs vices et leurs complexions» (Codex urbinas , fo 109 ro), car ils conservent les traces durables de leurs passions dominantes. Au XVIe siècle, divers théoriciens jugèrent utile d’inclure dans leurs traités un chapitre sur la physiognomonie, reprenant et adaptant les écrits des spécialistes. Ainsi Pomponius Gauricus qui, dans son De Sculptura de 1504, offrit la traduction latine un peu arrangée d’Adamantius, et après lui Francisco de Hollanda (1548), Giovanni Paolo Lomazzo (1584) et G. P. Gallucci, le traducteur des Quatre livres de Dürer (1591). Pour justifier leur initiative, ils expliquent que la physiognomonie doit permettre d’imaginer d’après leur caractère connu le visage des personnages historiques dont il ne reste aucun portrait, de composer des figures symboliques adéquates incarnant les vices et les vertus et d’introduire à loisir la variété dans les figures secondaires, totalement inventées, des scènes peuplées de nombreux figurants.
En réalité, les indications fournies par les traités de physiognomonie étaient à la fois trop précises et trop vagues, confuses, et même contradictoires d’un traité à l’autre, et donc difficilement utilisables par les artistes. Chez eux comme chez les romanciers, on constate plutôt une adhésion générale à l’esprit physiognomonique et à ses principes fondamentaux: l’extérieur exprime l’intérieur; le beau corps manifeste une belle âme et la laideur physique est signe de laideur morale; la beauté consiste dans la mediocritas , c’est-à-dire l’équilibre et la régularité. Pour le reste, peintres et sculpteurs se sont contentés des indices minimaux, des lieux communs qui permettaient à tout le monde de distinguer les bonnes et les mauvaises physionomies, le glouton de l’avare, etc., sans trop se préoccuper, apparemment, des détails contenus dans les traités. Mais il n’empêche que le goût nouveau pour les figures fortement «caractérisées» qui se manifeste dans l’art de la fin du XVe siècle et des premières décennies du XVIe siècle – par exemple dans la représentation des bourreaux du Christ et des saints martyrs – est à mettre en rapport avec la vogue contemporaine de la physiognomonie; et l’art de la caricature, qui naît un siècle plus tard, lui doit à la fois son principe fondamental et certaines de ses méthodes.
Un moyen d’indiquer le caractère d’une figure à travers sa physionomie était de lui prêter les traits d’un des tempéraments types. Il n’est pas du tout sûr que Dürer ait représenté les quatre tempéraments dans les Quatre Saints de la Pinacothèque de Munich, comme le voulait Erwin Panofsky. En revanche, le Saturne de Hans Baldung Grien (dessin à l’Albertina) présente tous les traits du mélancolique saturnien, que l’on retrouve parfois dans des portraits d’intellectuels ou d’artistes, surtout à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle (Girodet, Füssli...).
Autre moyen, bien plus important, de caractérisation: l’évocation de l’animal dans l’homme. Le sujet a passionné beaucoup d’artistes, et pas seulement Le Brun. Avant lui, Rubens (publié par Pierre Aveline en 1773) avait cru apercevoir dans les têtes sculptées des dieux et des héros antiques une similitude avec les traits des animaux «nobles», lion, taureau, cheval. Léonard déjà, dans un célèbre dessin pour la Bataille d’Anghiari , avait rapproché la tête d’un combattant hurlant et celles d’un cheval et d’un lion furieux. Dans les années 1770, Petrus Camper, professeur d’anatomie, montre aux étudiants de l’Académie de dessin d’Amsterdam qu’il y a du singe chez le nègre ou le kalmouk, tandis que l’homme grec (Apollon) se situe, par son angle facial, à l’opposé de l’animal. Lavater reprendra la démonstration à partir de la grenouille.
Les analogies animales chères aux physiognomonistes ont été parfois mises en œuvre dans des portraits. Là, on ne pouvait que suggérer. Pour indiquer le caractère courageux, viril, orgueilleux d’un guerrier, on a accentué les traits qui pouvaient rappeler ceux du lion, dans la chevelure abondante et bouclée, les muscles gonflés au-dessus d’épais sourcils, le regard direct: ainsi, semble-t-il, le Gattamelata de Donatello, le Colleoni de Verrocchio, le Cosme Ier de Médicis , de Cellini. Dans le visage de Sterne (National Portrait Gallery, Londres), Reynolds est parvenu à dégager ce qui, en rappelant l’homme-bouc, incarnait l’esprit satirique de l’écrivain – effet accentué par le graveur de Lavater.
Ce sont surtout les animaux à connotation comique ou mauvaise qui ont joué un rôle dans la création graphique. Les hybrides de della Porta ont précédé de peu les premières caricatures. Dès l’apparition de cet art dans l’Italie des Carrache puis de Bernin, la satire animalière est présente et l’on passe très facilement de la figure imaginaire, à la façon de della Porta, au «portrait chargé» en animal, comme celui du pape Innocent XI en insecte, dessiné à la plume par Bernin (Leipzig). Recommandée par F. Grose (Rules of drawing caricatures , 1788), la caricature zoomorphique a enchanté le XIXe siècle, de George Cruikshank (Zoological Sketches , 1834) à Lehnert (Traité physiologique de la ressemblance animale , 1839), de Grandville (Animalomanie , 1836) à Daumier, et elle fait toujours partie de l’arsenal de la satire politique, comme le prouvent Les Grandes Gueules ou le Bébête Show . La source ultime du procédé est physiognomonique, comme le postulat sur lequel repose toute la caricature, c’est-à-dire «le dedans jugé par le dehors», selon le titre d’un article de C. Philippon, le directeur du Charivari . Au XIXe siècle, les références à la physiognomonie et à la «physiologie» sont d’ailleurs explicitées dans les titres mêmes des recueils (Galerie physiognomonique de Traviès, etc.) et c’est en réponse à Lavater que Grandville donne au Magasin pittoresque , en 1843 et 1844, les deux séries de têtes où l’on voit un charmant enfant se transformer peu à peu en forçat et le Grec antique, un Apollon, régresser jusqu’à l’homme du XIXe siècle, une grenouille.
Au même moment, le dessinateur et humoriste genevoix Rodolphe Töpffer, rédigeait et illustrait un petit Essai de physiognomonie où il livrait, dessins à l’appui, ses réflexions sur l’expressivité des traits , ceux du visage et ceux que trace le dessinateur. Ce sont pour lui deux réalités bien différentes. Les traits permanents des visages rencontrés dans la vie ne nous offrent, ni pris isolément ni considérés dans leur ensemble, aucun critère certain des facultés intellectuelles et morales, mais seulement des probabilités, et encore, dans les cas où ces facultés sont particulièrement fortes ou faibles. La preuve: «À chaque instant dans la vie ordinaire, nous sommes appelés à réformer des erreurs physiognomoniques qui proviennent de cette faillibilité des signes permanents.» Au contraire, tout visage humain dès lors qu’il est dessiné, même par un dessinateur aussi maladroit qu’un enfant, possède ipso facto un certain caractère et une certaine expression, immédiatement intelligibles au spectateur. Il s’agira donc pour le dessinateur de découvrir, non pas en observant la nature mais en s’exerçant sur le papier, quels sont les traits capables de faire apparaître tel caractère ou telle expression. Rodolphe Töpffer fonde sa démonstration sur ses propres dessins, en présentant des séries de modifications et de variations successives et en dégageant à chaque étape la nouvelle signification. La conclusion, qui vise directement Lavater à travers l’erreur consistant à juger un individu réel d’après sa représentation par un artiste, est aussi une belle affirmation de l’autonomie de l’art: «Ceci [l’ambiguïté des signes permanents dans la réalité] n’empêche pas néanmoins que l’art, dans les combinaisons qu’il fait de ces signes entre eux et avec d’autres, n’arrive à produire à volonté des expressions d’intelligence et de caractère suffisamment claires et déterminées pour son objet. Mais parce que l’art fait là son métier légitime d’enchanteur habile ou de trompeur amusant, il ne faut pas s’autoriser de ses jeux pour étayer des systèmes qui sont quelquefois aussi pernicieux, philosophiquement parlant, qu’ils sont hasardés...»
La démarche de Töpffer, qui subordonne l’observation et l’imitation de visages réels pour exalter l’exploration des possibilités expressives du trait et la recherche de l’effet produit sur le spectateur, éclaire sans doute après coup celle de Léonard de Vinci multipliant ses «têtes grotesques». Il faut les comprendre elles aussi comme des expériences réalisées par l’artiste afin de voir ce qu’il obtiendrait en faisant varier les divers éléments d’un visage et quelles qualités expressives pourraient se dégager par exemple d’un visage au nez droit et au menton proéminent et d’un autre au nez courbe et au menton fuyant, comme les faces concave et convexe de Dürer – reprises par della Porta. On trouve dans certains dessins de Michel Ange et de ses élèves la trace de préoccupations semblables.
Pour Töpffer, praticien de la «littérature en estampes» inaugurée par Hogarth et l’un des pères fondateurs de la bande dessinée, l’art est un langage. Et les traits d’un visage dessiné «parlent» en effet à coup sûr et disent qui est leur possesseur. À vrai dire, ils ne font pas qu’en parler, ils le constituent et le personnage créé par l’artiste n’a pas d’existence ailleurs que dans l’œuvre. À côté de têtes grotesques nées au hasard sur le papier mais immédiatement dotées d’expressivité, selon la loi de Töpffer, Victor Hugo écrit: «Ceci ne sera jamais la tête de Dante», «Ceci ne sera jamais la tête de Shakespeare». On pourrait ajouter: parce que ceci sera toujours un dessin – et comme tel, témoignant bien moins des rapports du physique et du moral que des pouvoirs de l’encre et de la plume.
physiognomonie [ fizjɔgnɔmɔni ] n. f.
• 1562; lat. sc. physiognomonia, mot gr.
♦ Vieilli Science qui a pour objet la connaissance du caractère d'une personne d'après sa physionomie (⇒ morphopsychologie). Adepte de la physiognomonie (PHYSIOGNOMONISTE n. ).
♢ Ouvrage qui traite de cette science. La physiognomonie de Lavater.
● physiognomonie nom féminin (grec phusiognômonia, de phusis, nature, et gnômôn, qui connaît) Connaissance de l'homme intérieur par l'observation de l'homme extérieur. (Au XVIIIe s., J. K. Lavater a particulièrement développé le sujet.)
⇒PHYSIOGNOMONIE, subst. fém.
Étude du tempérament et du caractère d'une personne à partir de la forme, des traits et des expressions du visage. Synon. morphopsychologie (s.v. morph(o)-), physionomie. Son menton et le bas de son visage étaient un peu gras, dans l'acception que les peintres donnent à ce mot, et cette forme épaisse est, suivant les lois impitoyables de la physiognomonie, l'indice d'une violence quasi morbide dans la passion (BALZAC, Curé vill., 1839, p.15). La physiognomonie présente une grande richesse d'indications, s'il est vrai, comme le dit Kretschmer, que le visage est une sorte de «comprimé des impulsions trophiques», la «carte de visite de la constitution entière» (MOUNIER, Traité caract., 1946, p.219).
— P. méton. Ouvrage traitant de cette technique, de son application. La Physiognomonie de Lavater a créé une véritable science, qui a enfin pris place parmi les connaissances humaines; car, si, d'abord, quelques doutes, quelques plaisanteries accueillirent l'apparition de ce livre, depuis, le célèbre docteur Gall vint par sa belle théorie du crâne, achever et compléter le système du Suisse (BALZAC, Physiol. mar., 1826, p.151).
Prononc. et Orth.:[ ]. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. 1. a) 1565 «(par référence à Aristote et aux Anciens) art de déterminer le caractère d'une personne d'après les traits du visage» (ESTIENNE, Conformité, Mots pris du grec, p.216-217 ds HUG.), ds la lexicogr. à partir de Trév. 1721, Additions à la lettre P; b) 1781 «id., élevé au rang de véritable science» (J. C. LAVATER, Essais sur la physiognomonie, trad. de l'all. par Mme de Lafite, MM. Gaillard et Rengner, La Haye, I, p.22); 2. 1826 «traité sur l'art de juger le caractère de l'homme d'après les traits de son visage» (la Physiognomonie de Lavater (BALZAC, loc. cit.). Empr. au gr.
]. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. 1. a) 1565 «(par référence à Aristote et aux Anciens) art de déterminer le caractère d'une personne d'après les traits du visage» (ESTIENNE, Conformité, Mots pris du grec, p.216-217 ds HUG.), ds la lexicogr. à partir de Trév. 1721, Additions à la lettre P; b) 1781 «id., élevé au rang de véritable science» (J. C. LAVATER, Essais sur la physiognomonie, trad. de l'all. par Mme de Lafite, MM. Gaillard et Rengner, La Haye, I, p.22); 2. 1826 «traité sur l'art de juger le caractère de l'homme d'après les traits de son visage» (la Physiognomonie de Lavater (BALZAC, loc. cit.). Empr. au gr. «art de juger quelqu'un d'après son air, sa physionomie» (en partic. chez ARISTOTE, Physiognomonica, 806a 19 ds LIDDELL-SCOTT), dér. de
«art de juger quelqu'un d'après son air, sa physionomie» (en partic. chez ARISTOTE, Physiognomonica, 806a 19 ds LIDDELL-SCOTT), dér. de  «qui conjecture la nature d'une personne ou d'une chose par sa mine, son air», comp. de
«qui conjecture la nature d'une personne ou d'une chose par sa mine, son air», comp. de  «nature, manière d'être» et
«nature, manière d'être» et  «qui connaît, discerne».
«qui connaît, discerne».
 ]. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. 1. a) 1565 «(par référence à Aristote et aux Anciens) art de déterminer le caractère d'une personne d'après les traits du visage» (ESTIENNE, Conformité, Mots pris du grec, p.216-217 ds HUG.), ds la lexicogr. à partir de Trév. 1721, Additions à la lettre P; b) 1781 «id., élevé au rang de véritable science» (J. C. LAVATER, Essais sur la physiognomonie, trad. de l'all. par Mme de Lafite, MM. Gaillard et Rengner, La Haye, I, p.22); 2. 1826 «traité sur l'art de juger le caractère de l'homme d'après les traits de son visage» (la Physiognomonie de Lavater (BALZAC, loc. cit.). Empr. au gr.
]. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. 1. a) 1565 «(par référence à Aristote et aux Anciens) art de déterminer le caractère d'une personne d'après les traits du visage» (ESTIENNE, Conformité, Mots pris du grec, p.216-217 ds HUG.), ds la lexicogr. à partir de Trév. 1721, Additions à la lettre P; b) 1781 «id., élevé au rang de véritable science» (J. C. LAVATER, Essais sur la physiognomonie, trad. de l'all. par Mme de Lafite, MM. Gaillard et Rengner, La Haye, I, p.22); 2. 1826 «traité sur l'art de juger le caractère de l'homme d'après les traits de son visage» (la Physiognomonie de Lavater (BALZAC, loc. cit.). Empr. au gr. «art de juger quelqu'un d'après son air, sa physionomie» (en partic. chez ARISTOTE, Physiognomonica, 806a 19 ds LIDDELL-SCOTT), dér. de
«art de juger quelqu'un d'après son air, sa physionomie» (en partic. chez ARISTOTE, Physiognomonica, 806a 19 ds LIDDELL-SCOTT), dér. de  «qui conjecture la nature d'une personne ou d'une chose par sa mine, son air», comp. de
«qui conjecture la nature d'une personne ou d'une chose par sa mine, son air», comp. de  «nature, manière d'être» et
«nature, manière d'être» et  «qui connaît, discerne».
«qui connaît, discerne».DÉR. Physiognomoniste, subst. Celui, celle qui étudie ou pratique la physiognomonie. Synon. physionomiste. A-t-on bien le droit vraiment de tirer de pareilles conséquences de l'inspection des lignes d'un visage, fût-on le physiognomoniste par excellence, fût-on Lavater en personne? (SAINTE-BEUVE, Nouv. lundis, t.2, 1862, p.153). Lichtenberger écrit que ceux qui attendent le plus d'une morphologie mise en règle sont ceux qui ont la culture la moins universelle et que ceux qui ont cette culture donnent les meilleurs physiognomonistes (MOUNIER, op.cit., p.208). — [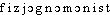 ]. — 1reattest. 1800 (BOISTE, avec renvoi à physionomiste); de physiognomonie, suff. -iste.
]. — 1reattest. 1800 (BOISTE, avec renvoi à physionomiste); de physiognomonie, suff. -iste.
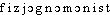 ]. — 1reattest. 1800 (BOISTE, avec renvoi à physionomiste); de physiognomonie, suff. -iste.
]. — 1reattest. 1800 (BOISTE, avec renvoi à physionomiste); de physiognomonie, suff. -iste.
physiognomonie [fizjognɔmɔni] n. f.
ÉTYM. 1562, Ronsard; lat. sc. physiognomonia, mot grec. → aussi -gnomonie, physionomie.
❖
♦ Vieilli. Science qui a pour objet la connaissance du caractère d'une personne d'après les traits de son visage. ⇒ Front, physionomie. — REM. De nos jours, on dit plutôt morphopsychologie.
1 Ils deviennent appris en la Mathématique,
En l'art de bien parler, en Histoire et Musique,
En Physiognomonie, à fin de mieux savoir
Juger de leurs sujets seulement à les voir.
Ronsard, Disc. des misères de ce temps, « Adolescence du Roi ».
2 (…) cette forme épaisse est, suivant les lois impitoyables de la physiognomonie, l'indice d'une violence quasi morbide dans la passion.
Balzac, le Curé de village, Pl., t. VIII, p. 547.
➪ tableau Noms de sciences et d'activités à caractère scientifique.
♦ (1835). Ouvrage qui traite de cette science. || La Physiognomonie de Lavater.
❖
DÉR. Physiognomonique, physiognomoniste.
Encyclopédie Universelle. 2012.